À dire vrai, j'ai encore tant de mots à souffler, tant d'images à visiter. Je les ai inscrits une nouvelle fois sur le papier et sur le net ; morceaux de vie puisés de mon terreau, fabriqués de photographies et de poésies...

EN ATTENDANT LE PRINTEMPS
L'hiver les pieds des femmes sont froids
et les peaux des hommes insensibles.
L'hiver les frileux s'enroulent dans leurs écharpes jusqu'au nez,
afin qu'on ne puisse les embrasser.
Rien ne résiste,
les écorces de chairs tendres se poudrent des frimas de décembre.
Je suis du printemps comme on est pour l'amour
du matin ou du soir,
je suis du printemps,
beaucoup,
passionnément,
à la folie
comme la marguerite qu'on effeuille pour savoir.


LA RÉALITÉ
UN CERTAIN PRINCIPE
Une pièce aux quatre murs aux angles parfaitement droits
avec une porte fermée à double tour.
Un mur blanc en plein été
sec et rugueux,
épuisé, délavé sur lequel personne n’a dessiné,
pas une tache de couleur,
pas un cri, pas une déclaration,
pas même un morceau de ciel.
Une sonnerie stridente de réveil au milieu d’un songe.
Une bizarrerie.
Un phénomène définitif.
L'Effectif.
Les mots de l'ennui comme
physique,
concret,
objet,
argent,
raisonnable,
nécessité,
théorie.
La réalité
ça ne se met pas en quatre pour être arrangeante,
ça ne s’invente pas,
ça ne se décarcasse pas.
C'est un ver rampant,
dévorant les cadavres des imaginables,
un empêcheur de danser en rond,
la muselière des fabriques à rêves.
Une petite dame au costume
étriqué,
minable,
conformiste,
pas bien reluisante.
Un fardeau écrasant.
La réalité c’est
un uppercut
un K.O.
Une définition très très sérieuse
dans un dictionnaire,
un Principe à la con.

LE SIGNE
Dans un instant
le signe se brouillera
et
disparaîtra
sous
les gouttes d'eau ruisselantes.
QUAND ON S'ALLONGEAIT DANS L'HERBE
fraîche
nous en avons rêvé des amours
et adoré y croire,
attendri les sols secs
de nos enveloppes courbes,
tenté de percer les mystères abyssaux
de la terre
des hommes.
Nous en avons soupiré des vies
et décidé d'en créer,
d'enfanter,
les ventres pleins et lourds
les entrailles habitées de chairs naissantes
dans nos gros corps de femmes,
nous avons délivré, accouché
sur la terre
des hommes.
Nous en avons donné du lait
de nos seins blancs
et ronds
à nos beaux petits d'hommes
gloutons,
de nos tétons tendus,
de nos ventres durs
de nos bras tendres,
nous en avons rassasié
sur la terre
des hommes.
Nous en avons donné des baisers
abreuvé des bouches insatiables
joui
et fait jouir d'amour
nos sexes,
nos peaux,
nos âmes,
de plaisirs avivés
l'herbe nous avons arrachée,
la terre nous avons griffée,
la tête aux nuages et aux coeurs amoureux,
nous avons possédé
sur la terre
des hommes.
Nous avons souffert
de la force violente
ou intempérante
nous nous sommes serré les coudes,
collées joues
contre joues,
blotties,
résistantes,
révoltées
et couronnées
nous avons protégé nos liens
et nos secrets
sur la terre
des hommes.

Alex, ma soeur, souviens-toi ce jour d'été au Mont Saint Michel, nous nous sommes allongées dans l'herbe fraîche et nous
avons rêvé à des histoires, nous avons ri et nous nous sommes chuchoté nos vies de femmes dans le creux de l'oreille.
LES FLEURS QUE TU M'AS DONNÉES
Le café fume dans le bol sur la table de la cuisine,
à travers la fenêtre, sur les jardins et les toits des maisons s'étale la couverture blanche des nuits de janvier.
Bashung chante à la radio que nous sommes immortels, qu'il ne l'a jamais dit et que c'est son secret.
Je prends le bol chaud dans mes mains pour les ranimer.
Je suis raide, le froid me gagne jour après jour,
gèle mes membres et mes articulations.
Je finis mon café, lave et range mon bol, ma cuillère, mon verre,
nettoie mon bout de table sali de miettes et de gouttes de café.
Le bruit d'un moteur, une voiture passe devant la maison, je m'en désintéresse très vite.
L'eau fume dans le lavabo de la salle d'eau.
Je passe mes mains sous le liquide clair et chaud,
je me brûle et m'en délecte.
Mon reflet s'estompe peu à peu dans le miroir, un voile de buée compacte me recouvre toute entière.
Je disparais.
Grise comme la pellicule de givre qui fige dehors.
Le miroir ne me dévisage plus.
Étrangeté naturelle.
Le temps s'ankylose.
Je n'ai rien dormi, comme d'habitude,
je n'ai rien rêvé non plus, par habitude.
La nuit reste à la nuit, avec sa lenteur et ses silences rompus par les cris des oiseaux noctambules et les chiens hurleurs des maisons voisines.
La nuit reste à la nuit avec les draps froissés, le noir impénétrable, le corps en chute libre, les idées et les yeux secs.
J'ai attendu l'heure acceptable pour me lever,
et traîné mes pieds sur le parquet ciré,
satisfaite d'avoir résisté à cette nuit encore.
L'heure est à la journée, l'hiver est à la froideur,
mes jours sont à l'attente de te voir encore.
J'ai dû jeter les fleurs que tu m'as données,
elles ont fané.
Tu sais,
seuls les baisers sont immortels.
À LA LUMIÈRE DU JOUR
je veux garder les yeux ouverts
te voir tout entier,
inscrire
au fond de moi
tes tours et contours
aux multiples facettes,
fermer les yeux
pour te trouver,
et ne devoir jamais
un autre éclat imaginer.
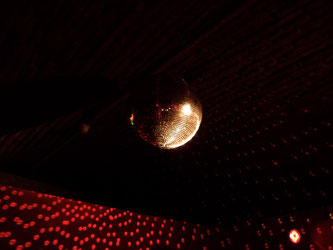

MOURIR UNE FOIS
Ces tombes de pierre,
immuables
aux surfaces intranquilles
sans cesse charriées par les vents
et les pleurs de la perte
en souvenir,
nous disent qu'il nous faut vivre
déraisonnables plusieurs fois
ou
mourir une fois.
DEVANT
nous,
une page s'écrit
qu'il nous faut compléter,
réinventer.
Ouvrons les yeux,
à l'infini
la ligne d'horizon
nous rappelle notre place sur la terre,
verticale,
debout,
nos deux jambes
arrimées au sol.
La terre fait sa ronde,
et nous marchons pourtant
droit devant,
où
le soleil se lève chaque jour sur la mer,
où
les prairies bourgeonnent au printemps, invariablement.
La terre fait sa ronde.
Nous allons pourtant
vers des rivages rouges du sang des gisants ensablés déposés par la mer,
des ersatz de lumière aux fausses promesses,
des tempêtes et des champs ravagés de colères,
des rêves engloutis de misère,
des maisons aux murs troués par les guerres,
des déserts de solitude,
des forêts aux poumons asphyxiés d'abandon,
vers nos espoirs et nos résolutions,
nos premières et dernières fois,
nos souvenirs enfouis d'une enfance perdue,
vers nos morts anonymes sur nos champs de bataille.
Héritiers égarés, malheureux, aliénés, lucides, sauvages ou sages,
nous vivants
au souffle fragile,
aux ailes de papillon,
virevoltant,
nous allons
qu'ils nous soient favorables ou non
portés par les vents
petites poussières d'étoiles
éphémères pourtant,
nous allons
quelque part sur la terre
droit devant.

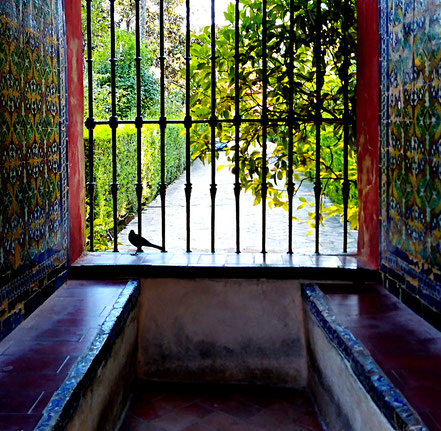
Ce petit coin au coeur des jardins de l'Alcazar semble avoir été imaginé pour les amoureux. Je m'y suis arrêtée un moment pour me reposer, un oiseau est venu me tenir compagnie.
LE RENDEZ-VOUS
Je t'attendrai dans le jardin
sur un petit banc frais,
à l'abri des regards
dans le jardin,
près de la fontaine aux poissons
rouges
et jaunes,
je t'attendrai,
dans l'air chaud
de
la fin du jour,
grisée par le parfum des orangers,
je fermerai les yeux et
m'endormirai
peut-être,
dans les bras des murmures du clapotis
bercée par les variations
d'un oiseau chanteur
venu se poser
là,
près de moi,
et si tu t'approches
sans faire de bruit,
tu pourras
déposer un baiser sur mes lèvres
ou dans le creux de mon cou,
ainsi je devinerai ta chaleur
et pourrai t'embrasser à mon tour
pour te dire bonjour.
IL Y A UN PARFUM
d'enfance
sur les bords de l'océan,
un parfum d'immortelles
comme les histoires
racontées aux enfants.


photo provisoire
INCOGNITO
Il y a très longtemps,
j'ai habité une chambre froide au carrelage beige,
avec une porte fenêtre sans rideau,
meublée d'un lit à une place,
d'une chaise,
d'un secrétaire au bazar permanent,
décorée de posters,
de pages arrachées aux magazines punaisées sur le mur au papier peint bleu clair ;
au bout d'un long couloir avec des appliques murales de chaque côté auxquelles il manquait souvent une ampoule,
d'une maison à la façade au crépi de peinture jaune,
bordée d'un jardin où trônaient un petit palmier et des lauriers roses,
d'une rue jonchée d'autres maisons avec leurs petits jardins, leurs petits palmiers et leurs lauriers roses,
d'un lotissement parmi d'autres lotissements,
d'un village avec une église tout en haut de la côte.
J'ai habité en banlieue,
dans une cité-dortoir,
mais je ne dormais pas,
trop occupée à m'ennuyer.
Je m'ennuyais le matin,
je m'ennuyais le soir.
Dans les maisons en construction du lotissement,
j'allais crapoter des cigarettes,
en cachette,
dans le gris des briques,
ton sur ton,
incognito.
J'allais m'exercer à embrasser,
avec la langue,
des garçons
d'autres lotissements
qui cachaient leurs mobylettes
derrière les murs de briques à demi construits,
incognito.
J'allais rêver à une vie,
assise en tailleur sur les chapes de béton,
avec les filles des maisons voisines,
qui s'ennuyaient le matin,
qui s'ennuyaient le soir
dans leurs chambres au bout de longs couloirs
avec des appliques murales de chaque côté
auxquelles il manquait souvent une ampoule.
UNE RÉVOLUTION
Sur les draps séchés au soleil
se profile mon image,
l'ombre me dessine trait pour trait.
J'ai dans la tête des fils enroulés,
déroulés,
courbes et colorés,
tissés d'histoires,
de contes empruntés aux enfants,
des méduses venimeuses,
des étoiles de mer
et des points à la ligne.
Comme un chat,
entre les draps, je me faufile,
me perds dans ce dédale
de linge raide gavé de soleil
à l'odeur fraîche de lessive.
Je m'accorde le temps de la déambulation,
un saison d'été,
la première des quatre,
absolues nécessités,
pour minutieusement
démêler les noeuds du fil de mes pensées.
J'attendrai l'automne,
ses pluies de feuilles rougies,
ses cieux ombrageux aux trouées de lumières intenses,
je prendrai plaisir à y voir des lignes et des signes,
canevas de mes petits arrangements avec l'insoutenable réalité plombée de silences, d'indifférence et de violence.
Je m'inventerai encore
des départs sur des quais de gare,
des mystères à élucider,
des îles merveilleuses aux mers bleu azur,
des vues sur des neiges éternelles
et sur des horizons joyeux de baisers et de caresses.
Je résisterai à la froideur de l'hiver,
me réchaufferai aux creux de sourires et de regards attentifs,
au coin du feu de mes désirs.
Patiemment, m'extirperai, centimètre par centimètre, du tombeau de mes pensées pourrissantes.
Puis au printemps, le coeur plus léger qu'un chant d'oiseau au point du jour,
j'aurai enfin tiré les fils un à un,
distingué le vrai du faux,
liquidé les chimères et les fantômes de ma mélancolie,
débarrassé ma tête des méduses et des ogres.
J'accueillerai,
apaisée,
le soleil de l'été,
traverserai des ruelles étroites,
emprunterai une allée bordée d'oliviers,
m'inviterai dans une maison aux murs blancs,
aux volets à la peinture bleue écaillée par les vents marins,
il y aura sur la table des figues et des oranges sanguines,
sur le lit des draps propres séchés au soleil,
je déposerai ma robe sur la chaise,
c'est alors que nous nous reconnaîtrons mon ami.

Clin d'oeil à Alicante mon poème préféré de Jacques Prévert

LES PLUIES DE FEUILLES ROUGIES
annoncent
la fin de l'automne
la disparition
des longues journées saturées de lumière ;
consolons-nous,
sous notre latitude
la nuit du solstice d'hiver
s'étire à l'infini,
abandonnant
les amants
à la fièvre
d'un soleil de minuit.
NATURE MORTE
Quatre oranges posées sur la table
quatre petites oranges
moins une,
trois oranges posées sur la table
trois petites oranges
moins une,
deux oranges posées sur la table
deux petites oranges
moins une,
une orange posée sur la table
une petite orange
moins une.
Et puis plus rien.


CATASTROPHE
NATURELLE
Un astre
rayonne
réchauffe
ma terre entière
je fonds

LE JOUR DE TA MORT
Comme un jour ordinaire,
je suis sortie de mon lit,
j'ai câliné ma fille,
respiré sa peau sucrée,
je lui ai préparé son biberon de lait chaud au chocolat,
on s'est chatouillées sur le lit,
on a bien ri.
J'ai bu un café,
nous nous sommes régalées de tartines de confiture et de miel ;
il faisait chaud
ce jour là
au coeur l'été.
On s'est débarbouillées,
nous avons mis nos robes
et
nous sommes sorties nous promener au Jardin des Plantes,
un peu par habitude,
un peu par facilité.
Le jour de ta mort,
je pensais à mon anniversaire qui allait arriver,
à inscrire la petite à la crèche pour la rentrée,
à ce que j'allais bien pouvoir préparer pour le déjeuner.
Le jour de ta mort,
je n'ai pas pensé à toi,
comme on pense parfois à ceux qu'on aime en se demandant s'ils font les mêmes choses que nous au même moment.
Je ne sais d'ailleurs pas le moment exact où ton coeur a cessé de battre dans ta cage thoracique.
Peut-être que c'était pendant qu'on riait,
pendant qu'on se coiffait ou pendant qu'on se léchait le bout des doigts pleins de confiture.
Le jour de ta mort,
je ne t'ai pas téléphoné
pour te dire des mots tendres,
des mots qui remplissent le coeur,
peut-être qu'il aurait repris le cours de sa vie
ton coeur,
avec ces mots-là ;
c'est vrai, les mots d'amour ça ravive.
Le jour de ta mort,
je ne t'ai pas dit que sans toi dans mon sillage je ne saurai plus me tenir droite,
que ma peine allait laisser un trou dans mon estomac,
un goût d'inachevé dans ma vie,
que ce n'était pas logique,
qu'il nous fallait encore nous fabriquer des souvenirs,
que tu devais tenir le coup,
que nous avions rendez-vous,
que j'aurais voulu m'occuper de toi vieux,
comme font les gens.
Le jour de ta mort,
tu étais trop jeune pour ça
et moi aussi.
À VRAI DIRE
Ce qu'il faut de couleurs,
de formes,
de contrastes,
de mystères esquissés,
de beautés observées,
de poésies inventées,
de voyages racontés
et de paroles justes
pour nous affranchir
de nos chaînes invisibles.
Matisse et tous les autres n'y pourront rien changer,
je ne sais plus si le vert de la robe de Lorette est bien vert,
ni, si les yeux fermés, je pourrais en détailler avec précision le portrait.
Le doute prend place,
s'installe bien confortablement.
Ainsi va la vie ;
peut-être que je ne le saurais plus jamais vraiment.

Thérapie

Wonder Woman
DE CORPS À CORPS
Je me souviens,
je me mettais sur la pointe des pieds,
levais les bras pour atteindre le trapèze
du portique au fond du jardin,
prenais dans mes mains le morceau de bois à bout de bras,
mes pieds quittaient le sol et je m'enroulais sur moi-même,
pendue par les jambes,
petit cochon de lait,
la tête en bas,
le ventre à l’air,
les cheveux traînant,
le sang tapait dans mes tempes,
j'ouvrais les yeux pour voir le monde à l'envers.
Je pédalais sur mon vélo trop grand,
le guidon tremblant,
je tombais
et recommençais.
Je grimpais aux arbres,
passais de branche en branche,
en équilibre précaire pour cueillir les cerises les plus hautes,
celles gorgées de sucre et de soleil.
J'appuyais fort sur le stylo pour dessiner des lignes de chiffres et de lettres en tirant la langue pour m'appliquer.
Les égratignures, les croûtes de sang séché,
les pansements et le Mercurochrome étaient autant de marques de fierté, de preuves de bravoure de casse-cou et objets de convoitise de mes congénères.
Mon corps n'était pas un problème,
Je le découvrais, je l'apprivoisais.
J'avais cinq ou six ans.
Je me souviens,
je cavalais tout en haut des talus,
m'allongeais sur l'herbe chaude, trempée de sueur,
m'élançais et roulais sur moi-même jusqu'en bas,
restais sur le dos,
haletante,
les joues en feu,
les bras en croix à regarder le ciel tourner,
tourner ;
c'était, à vrai dire, le but recherché.
Mes dents tombaient et ma langue s'enroulait avec plaisir dans les trous laissés sur mes gencives.
Je sautais à la corde,
à l'élastique,
à pieds joints,
à cloche-pied,
à la Marelle de l'Enfer jusqu'au Ciel,
de joie,
de colère,
d'excitation,
de bonheur,
sautais en toutes circonstances.
Mon corps était un espace de jeu.
Je l'éprouvais, je m'en amusais.
J'avais sept ou huit ans.
Je me souviens,
j'enfilais les chaussures à talons de ma mère pour danser sur la musique de "heart of glass" dans le salon de l'appartement, chantais à tue tête
« ça plane pour moi moi moi moi » devant le miroir de la salle de bain,
faisais fièrement le grand écart, le pont, la roue, la rondade, la galipette avant et arrière,
parvenais à mordre mes orteils (y compris les petits),
gagnais les batailles de pieds contre mon frère,
ce qui nous pliait de rire et nous faisait délicieusement mal au ventre,
tirais des pénalties de toutes mes forces,
roulais en patins sur les trottoirs parisiens,
écrasais ma figure sur les vitres de la R5 pour grimacer.
Mon corps était maîtrisé.
Je le connaissais, je le dirigeais.
J'avais neuf ou dix ans.
Je me souviens,
Je sprintais après le car, le matin,
sautais encore pour fêter la victoire de Mitterand,
décidais de pleurer à chaudes larmes la mort de Brassens,
nageais dans des eaux très froides,
m'éloignais dangereusement du rivage,
m'élançais dans les vagues immenses,
sautais sur les pierres glissantes dans les cascades des rivières,
gravissais les montagnes,
plongeais du haut des rochers,
au fond de l'eau,
retenais ma respiration longtemps.
Mon corps était fiable.
Je le libérais, je le vivais.
J'avais douze ou treize ans.
Je me souviens,
la douleur dans mon ventre,
le sang coulé,
la culotte tachée,
la poitrine gonflée,
les formes de mes fesses
et de mes hanches s'évaser,
ma taille se courber.
Les regards changer.
Mon corps était embarrassant.
Il m'échappait, il débordait.
J'avais quatorze ou quinze ans.
Je me souviens,
c'est à ce moment là
que tout a commencé
à déconner.
AU BOUT DU COMPTE
Quoi qu'il y ait
au bout du compte,
quoi qu'il se passe
au bout du compte
j'irai.
Je ne retournerai pas la tête
pour regarder derrière
je l'ai assez fait.
Au bout du compte,
si c'est un voyage sans retour
si c'est un miroir sans reflet
si c'est une histoire sans amour
au bout du compte
j'irai.
Dans le désordre et l'agitation
les mains vides et le coeur plein
quoi qu'il se dise,
j'irai.
Résolue, intrépide, incorrigible
jusqu'aux derniers remparts,
jusqu'en haut des montagnes,
jusqu'au fond des bois,
jusqu'au bout de ce monde,
j'irai.
Je percerai les mystères des Infiniments,
je porterai en moi tous les rêves
possibles, impossibles
extravagants et fous,
je retrouverai la candeur de l'enfance.
J'ouvrirai les yeux,
toucherai de mes mains,
caresserai de ma peau,
respirerai de mes poumons,
oublierai ce que je sais,
pour inventer des choses nouvelles.
Alors au bout du compte,
je saurai.


Les poissons des bassins de l'Alcazar - Séville octobre 2018 -
Je m'approche du bassin dans les jardins d'orangers, de palmiers, de magnolias aux odeurs entremêlées de myrtes et des rosiers. Le silence règne, il n'y a que le bruit de l'eau qui coule de la fontaine, j’y découvre ces taches mouvantes de rouge et de jaune. Cela m'émeut et je ne saurais dire pourquoi ; il s'agissait juste à ce moment-là de me laisser gagner par la douceur de ce spectacle.
LES POISSONS DANS LE BASSIN
de la fontaine,
ondulent en silence et
n'ont que faire
du désordre du monde.

J’AI PRIS UN TRAIN
un matin d'hiver,
j'ai pris un train
en février je crois.
Le trajet que je m'apprêtais à faire,
je l'avais fait déjà,
dans un sens et dans l'autre,
dans l'autre et dans un sens.
Je le connaissais bien.
Je l'avais fait seule bien des fois,
et à cet instant,
à 17 ans,
j'allais à nouveau le parcourir.
C'était un long voyage,
du Sud à l'Ouest,
il fallait passer la Garonne et la Loire.
Il fallait passer du rouge des tuiles au bleu des ardoises,
du soleil trop chaud à la bruine légère,
des rivages de sable fauve à la verte campagne,
de la terre sèche aux mousses humides des forêts,
des flamants roses aux vaches pleines de lait,
des cornes des taureaux à la crinières des chevaux,
de la confusion à la clarté,
de la résistance à la résilience,
de l'agitation au calme.
Il faisait froid sur le quai de la gare,
j'ai embrassé, dit "au revoir", sans gravité,
comme si j'allais rentrer le soir alors que je n'étais déjà plus là.
Après avoir arpenté le couloir du wagon avec mes bagages, je me suis installée sur un siège côté fenêtre.
À ceux qui restaient sur le quai,
j'ai dit à nouveau "au revoir" d'un geste de la main,
sans un sourire je pense, à cette époque là il était perdu, laissé dans un coin de mon enfance sous une pile de douleurs, de tourments et de sidération.
Le train a démarré tout doucement,
la gare s'est mise en mouvement sous mes yeux, sans bruit, tranquillement.
J'ai posé mon front contre la vitre humide et froide,
j'ai regardé mon visage dédoublé dans le flou du reflet de la vitre éclairée de lumières artificielles.
Au sortir de la ville, la gare a laissé place à la banlieue ;
un flottement,
un bercement,
puis une rythmique,
un tangage cadencé et régulier,
une musique.
Quand le train inflexible glissant sur ses rails a pris de la vitesse, j'ai fermé les yeux,
senti très nettement
mon coeur se desserrer et
un grand soulagement m'envahir.
LE MONDE À L'ENVERS
Si on retournait le monde
on pourrait simplement voir
des soleils à l'envers le jour
et des étoiles à l'envers la nuit
mais on pourrait aussi voir
des nuages à l'envers sur l'eau
et des arbres à l'envers dans le ciel,
ou bien le contraire,
tout n'est qu'une question de point de vue.

"ÇA M'GARDE EN VIE JUSQU'À TEMPS QUE J'MEURE"
(les amours imaginaires - X. Dolan)
Ça ne prévient pas vraiment,
ça attrape sans déranger,
un jour sans fond
ou un jour de l'ordinaire,
un matin repu de sommeil,
ou après une nuit agitée de plaisirs inventés
et d'images joyeuses,
l'esprit se met à divaguer,
il devient jardinier
il sème une petite graine,
une fantaisie,
une petite pousse,
une idée d'amour.
Alors la tête du rêveur s'agite
et tous ses sens, paupières mi-closes,
s'engagent dans la même direction,
celle qui éprouve la chair,
celle qui fait la peau frisson,
celle qui les sort de la tombe
et les rend au monde des vivants.
Les sauvages dénudés,
écorchés,
à vif,
la peau à fleur,
d'instinct,
scrutent,
flairent
l'appel,
l'alchimie,
le tout petit minuscule infime troublant petit signe
qui dirait
je t'aime toi,
toi qui m'observes du coin du coeur,
je t'aime autant que toi
tu m'aimes ;
mais les aimés aux visages sans regard pour les adorer,
sans oreille pour croire à la justesse de leurs chants,
aveugles et sourds,
les cruels aimés
s'assèchent d’indifférence.
Alors,
les Marie, les Francis,
les imaginaires
se taisent,
bouclent leur coeur,
marquent d'un trait leur défaite,
protègent leur secret
parce qu'il est doux et sucré d'aimer
et tant pis pour le reste.


L'EFFET PAPILLON
Attention,
une oscillation
nouvelle,
infime,
peut provoquer
un raz de marée,
un chaos,
une tornade.
C'est mathématique !
CONTRE UN MUR À PORTO
ou ailleurs,
la femme de chambre
fait la pause,
contre un mur
dans la rue,
dans la chaleur de l'été,
les femmes de chambre
font leur pause,
contre un mur.
Profite la belle,
aujourd'hui il fait beau,
profite de ne rien faire,
c'est ta pause.
Six heures travaillées,
c'est écrit dans les textes,
vingt minutes de pause
pour six heures travaillées,
vingt minutes à toi,
alors,
contre un mur
pose les chiffons et
les balais
oublie les six heures
de draps sales
de serviettes tâchées,
de plateaux à débarrasser,
de lits à défaire,
de lits à refaire,
les machines à laver,
les machines à sécher,
les machines à broyer,
les escaliers à monter,
les escaliers à descendre,
puis à remonter.
Repose ton dos,
repose tes pieds,
repose ta tête
fume ta cigarette,
ne pense pas à ce soir,
quand tu rentreras chez toi,
fatiguée,
ne pense pas à demain matin,
quand tu te lèveras
fatiguée,
ne pense pas à la fin du mois
à boucler ;
une heure travaillée
sept euros cinquante deux gagnés,
une heure travaillée,
une heure de ménage,
une heure de repassage,
une heure de nettoyage
pour le moment
c'est
la
pause,
contre un mur à Porto
ou ailleurs.

Dans les rue de Porto - Aout 2012
L'instant d'avant la femme m'a regardée et m'a souri, celui encore avant nous nous observions mutuellement, du coin de l'oeil pour elle, du coin de l'objectif pour moi - nous nous sommes comprises sans devoir nous parler -

L'ENVOL
Parfois je flotte,
un frisson,
puis
un léger balancement me détache du sol
alors
je reste là,
entre le ciel et la terre ;
je ferme les yeux,
mon corps ne pèse plus,
et
j'adore ça.
C'est imperceptible aux yeux du monde
si fugace, si fragile
qu'il ne faut pas bouger,
sous peine de rompre le charme.
J'ai remarqué que cela se produit
quand je pense
au soleil, celui qui réchauffe les murs blancs des maisons ;
au ciel, celui qui dessine des lignes bleues entre les ruelles étroites ;
aux étoiles,
celles qui illuminent les nuits noires ;
aux étincelles,
celles de mon coeur quand je te vois.
POINT DE VUE
Je veux croire
à la force mon ventre durci
à la chaleur de mes joues
à l'écho de ma voix ;
je veux croire
aux brûlures de la peau
des jours aux draps froissés,
aux "Il était une fois" ;
je veux croire
aux nuits sans sommeil,
et aux petits matins ;
je veux croire
aux haleines sauvages
des corps emmêlés,
à la rougeur laissée
de tes doigts sur mes seins ;
je veux croire
à la peau,
aux souffles haletants,
aux regards soutenus,
infinis,
ardents,
aux marques d'amour
et aux promesses d'un éternel printemps.


UNE QUESTION D'ÉCHO
Glacée,
je cherche l'apaisement dans la chaleur
de la flamme
mais
une étrangeté a élu domicile
en mon intimité,
Cerbère ou sentinelle
aux aguets chaque jour
sur mon chemin,
barrant ma route,
entravant de parmi les vivants
mon possible retour ;
je ne peux m'extirper
des ses grises vallées,
de ses vagues dormantes
glaçant ma tête et mes membres,
aux miroitements aveuglants
contrainte aux bras tendus,
aux mains devant,
tâtonnant,
approchant de la flamme
sans jamais me brûler,
saisie par cet étrange froid
mes membres sont engourdis,
mes doigts sont sans empreinte,
mes mains sans ligne dessinée,
nul indice, nul témoin
ne résonne.
Il n'y a que le trouble
et l'infini
écho de l'aube de ma vie.
DE L'OR SOUS MES PIEDS
Je voulais vous offrir un joli portrait,
je ne possède
ni or,
ni bijou précieux,
alors,
je me suis habillée
avec ce que j'ai trouvé
sous mes pieds.


JUSTE APRÈS L'ORAGE
Je suis partie juste après l'orage,
les éclairs se sont raréfiés et
enfin le ciel s'est tu ;
il pleuvait encore beaucoup quand
nous sommes sortis de la maison.
Chacun de nous gardant ses mots,
chacun de son côté,
déjà ;
Nous nous sommes hâtés sous la pluie,
chargés de mes quelques bagages,
embarrassés, empêtrés dans la réalité.
J'ai pris l'essentiel,
juste ce à quoi je tenais vraiment.
Tu m'as aidée à ranger ma vie dans le coffre.
Le fort d’une histoire, ça tient dans pas grand chose ;
deux sacs et une valise seulement.
Je me suis installée derrière le volant,
j'ai claqué la portière ;
sans respirer, il m'a semblé.
On s'est regardés à travers la vitre ruisselante,
longuement peut être.
Puis tu as tourné les talons,
d'un pas pressé,
les poings dans les poches,
trempé de la tête aux pieds.
Je t’ai observé, je ne t’avais encore jamais regardé comme cela,
étrange, étranger ou étrangère à présent.
Dénoués, détachés de nos intimités.
J'ai démarré tout doucement dans l'allée,
les pneus crissaient sur le gravier.
J'ai pensé aux soirs où nous rentrions tard
et que tu roulais lentement pour ne pas réveiller les enfants.
Cela m'a serré le coeur.
L'olivier et les figuiers étaient décoiffés par les vents violents
qui s'étaient abattus sur nous l'instant d'avant.
La petite porte du fond du jardin a claqué.
À travers les gouttes,
dans le rétroviseur,
j'ai vu qu'il y avait encore de la lumière dans les pièces du bas de la maison,
que la petite table en bois au fond du jardin était trempée.
J'ai dépassé lentement la grille rouillée du portail.
La pluie a cessé.
J'ai tourné à droite,
me suis engagée sur la grande route
et j'ai commencé à rouler un peu plus vite.
Ce n'est qu'une fois arrivée sur l'autoroute
que j'ai pu pleurer.


